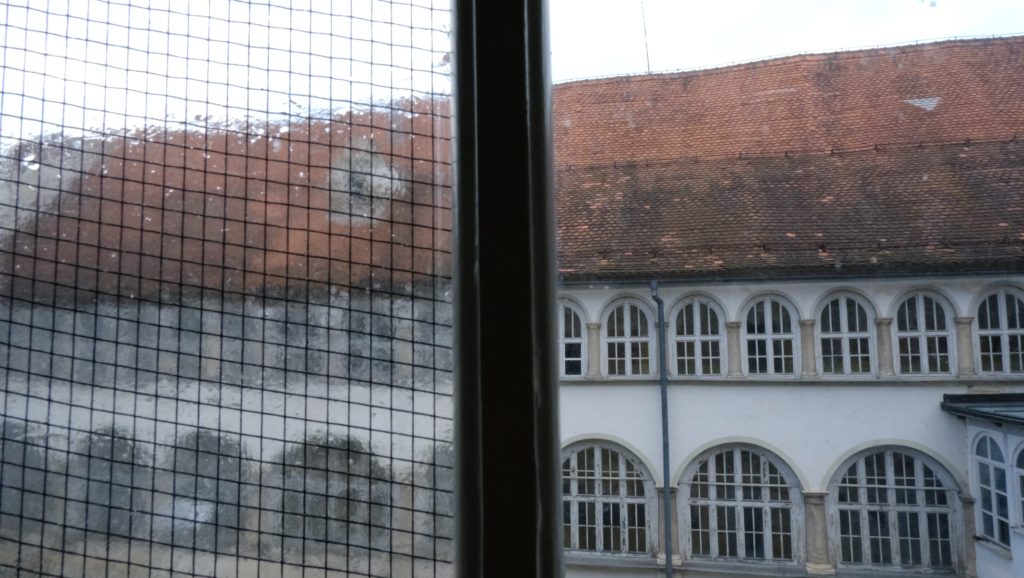Enfermement 24h/24, contention pendant des heures, violence, isolation, infantilisation… c’est le sort qui est réservé à beaucoup de personnes souffrant de troubles psychiques en Slovénie. Depuis quelques années, le pays tente tant bien que mal de faire évoluer cette prise en charge de la santé mentale. Pour quel résultat ? Malade, proches et soignant·e·s témoignent.
Joc Podlesnik, 59 ans, coince une cigarette entre son index et son majeur tandis que nous nous promenons dans Prešeren Square ‒ sans doute l’un des plus beaux parcs de Ljubjana. Alors que son ami écrivain, journaliste et activiste, Andraž Rožman, et moi discutons, Joc nous suis en gardant toujours une petite distance. Régulièrement, il s’éloigne un peu plus, puis se rapproche, salue une connaissance, allume une nouvelle blonde, ramène une boîte de conserve d’on ne sait où et s’arrête pour passer un coup de fil. La chaleur inhabituelle que Ljubjana endure depuis plusieurs étés ne perturbe pas Joc dans ses pérégrinations en ville. S’il a besoin d’échapper à la chaleur qui essouffle et étourdit, il sait qu’il peut nager dans la rivière Ljubljanica. Ces rues sont sa maison. À chaque fois qu’il a été forcé de les quitter, il a souffert.
Roi de la rue
Notre promenade nous mène aux bureaux de l’association Kralji ulice – “roi de la ville” – dédiée aux personnes dans le besoin, qui publie son propre journal. Son prix, un euro, permet à beaucoup de personnes sans-abris, souffrant d’addiction ou de troubles psychiques d’avoir un revenu en Slovénie. Devant les locaux s’étend une foule constituée en grande partie d’hommes. Ils viennent ici soit pour vendre des journaux soit pour trouver du réconfort. En ce moment, Joc fait partie de la deuxième catégorie. Il se sent en sécurité à Kraji ulice et y vient régulièrement pour voir des ami·e·s. Aujourd’hui, il va aussi y recevoir un billet gratuit pour un match de basket. Pour le fan qu’il est, c’est une « nécessité absolue » !
« La première fois en 1982, ils m’ont lavé comme un porc avec de l’eau froide sortant d’un tuyau noir »
Petit, Joc voulait étudier l’histoire et la géographie. Il était attiré par les pays exotiques, les villes qu’il ne connaissait pas et tous les autres mondes. Quand sa schizophrénie paranoïde a été diagnostiquée, il a été admis en unité psychiatrique et tous ses plans sont tombés à l’eau. « La première fois en 1982, ils m’ont lavé comme un porc avec de l’eau froide sortant d’un tuyau noir », se souvient-il. « Le plus effrayant dans tout ça, c’est quand vous devez vous déshabiller. Deux grands types, qui sont des techniciens médicaux, vous escortent jusqu’à la salle de change. Si vous êtes trop lent, vous risquez de vous faire frapper », explique-t-il d’une voix résignée.
« L’histoire de Joc est d’abord un témoignage du passé de notre système de santé », commente Andraž. Et sans tarder, il ajoute : « Mais c’est aussi un témoignage du présent : les conditions dans les institutions psychiatriques fermées n’ont pas beaucoup changé à ce jour. »
Violence légale
Andraž n’est pas surpris d’entendre Joc décrire les conditions inhumaines dans lesquelles les personnes avec des problèmes psychiatriques ont vécu ‒ et continue à vivre ‒ en Slovénie. Dans ce pays, comparé aux autres membres de l’UE, la désinstitutionnalisation de leur prise en charge a commencé tard et timidement. Le processus était par exemple à son apogée en Italie en 1980 quand les admissions dans des hôpitaux psychiatriques furent interdites par la loi. Dans ce pays voisin, les personnes dont la santé mentale était atteinte de façon chronique et sévère ont été redirigées vers différents centres régionaux spécialisés. L’évolution n’a pas été imitée de l’autre côté de la frontière.
D’après la rhétorique des détracteur·ice·s slovènes de la désinstitutionnalisation, ce processus avait beaucoup de défauts et d’effets négatifs potentiels, comme une supposée augmentation du nombre de personnes se retrouvant à la rue et un manque de soin pour les patients atteints de troubles psychiatriques. À ce jour, aucune institution n’a complètement fermé en Slovénie. Les nombres d’unités et d’institutions de long séjour ont même augmenté et celles déjà existantes ont été rénovées. Alors que les protocoles sont prêts, peu d’opportunités de réintégration à la société sont proposées aux patients.
« Les gens viennent en psychiatrie dans un état de frayeur et de détresse, s’exprimant souvent de façon agressive. En retour, ils reçoivent de la coercition et de la violence. »
En tant qu’activiste et écrivain, qui explore la question de la santé mentale dans ses documentaires, Andraž a entendu des dizaines de récits similaires à celui de Joce, confie-t-il. Une partie de la violence dans les hôpitaux psychiatrique est légale ‒ comme le fait d’être attaché pendant quatre heures ‒ une autre est illégale, mais existe toujours ‒ comme les contentions excessives, jusqu’à dix jours, la déshydratation intentionnelle ou le fait de frapper au niveau des parties génitales. « Les gens viennent en psychiatrie effrayés, en détresse, s’exprimant souvent de façon agressive. En retour, ils reçoivent de la coercition et de la violence. Des traitements sont fournis, mais il n’y a clairement pas assez de thérapie basée sur la parole », analyse Andraž.
Carrière de fou
Lorsque Joc a commencé sa « carrière de fou », comme il aime dire, on utilisait d’autres méthodes comme les électrochocs et l’insulinothérapie. Ces pratiques ne sont plus en vigueur, mais la violence, elle, est toujours là. Andraž côtoie tous les jours des individus qui travaillent ou ont travaillé dans ces institutions. « Le personnel traite souvent les patient·e·s non pas comme des sujets, mais comme des objets, sans accorder d’importance à la volonté de la personne concernée. Pour tordre cela, un changement fondamental dans la façon de penser et dans le système sont nécessaires », théorise-t-il.
Joc est un homme très attentionné. Sur le trajet qui mène à son appartement de l’autre côté de Ljubjliana, il parle de changement climatique, de football, de vente d’antiquités et de pêche. Tous ces hobbies sont visibles dans sa chambre encombrée, où il est difficile de pénétrer à cause de l’abondance d’objets. Les murs sont recouverts de photos de sportifs, d’images de femmes et de copies d’œuvres d’art. Les étagères sont remplies de livres, magazines et albums photo renfermant les portraits de personnes avec lesquelles, pour certaines, Joc n’a plus de contact et d’autres qu’il continue à fréquenter. Quand Andraž et Joc ne se donnent pas rendez-vous dans le centre de Ljubljana pour un café et un croissant ‒ la viennoiserie préférée de Joc ‒ c’est ici que les deux amis passent du temps ensemble.
« En matière de logement, Joc a toujours été sur la brèche », explique Andraž, installé dans la chambre de son ami. Il a eu son propre appartement pendant un temps, a été placé dans une résidence de l’Association slovène pour la santé mentale (ŠENT), puis s’est retrouvé sans-abris durant une petite période. En 2017, il a déménagé dans son logement actuel, un appartement de la Ljubljana Housing Fund, une “institution sans personnel”. Chaque citoyen·ne de Ljubljana peut théoriquement prétendre à ce type d’habitat. Et espérer être accepté·e à condition de cocher certains critères : chômage, handicap, vulnérabilité sociale. Cependant, aucun soutien n’y est apporté aux personnes avec des troubles psychiatriques, même à celles ayant auparavant longtemps vécu en institution, pour réaliser des tâches quotidiennes qu’elles peineraient à accomplir par elles-mêmes. Il en va de même pour les soins physiques ou psychologiques dont elles auraient encore besoin.
Comme, d’après les autorités, Joc n’a pas respecté les règles ‒ ce qu’il réfute ‒, il doit partir. Il pourrait de nouveau se retrouver dans la rue.
L’immeuble aux longs couloirs blancs et salles de bain partagées abrite des personnes aux vécus parfois très différents. S’y côtoient des individus avec des troubles psychiatriques, des sans-abris, des individus coupables de violence et d’autres victimes de violence. Tou·te·s les résident·e·s peuvent aller et venir à leur guise, mais ils et elles doivent obéir à certaines règles, dont l’interdiction des visites après 22h. Comme, d’après les autorités, Joc n’a pas respecté les règles ‒ ce qu’il réfute ‒, il doit partir. Il pourrait de nouveau se retrouver dans la rue.
Joc fait partie de celles et ceux qui ont réussi à sortir du soin institutionnalisé ‒ jusqu’à un certain point ‒, mais sa vie pourrait être bien différente avec un soutien approprié. Cependant ce type de soin n’en est qu’à son balbutiement en Slovénie et les institutions fermées traînent une longue histoire derrière elles. Andraž se souvient de l’une des premières unités à avoir fermé en Slovénie : le Trate Institute implanté au château de Cmurek entre 1949 et 2004, une branche du plus grand Hrastovec Institute dont certains services sont toujours en activité aujourd’hui. Le Trate Institute a d’abord accueilli des infirmes (qui étaient aussi souvent pauvres et sans famille), puis des personnes aux troubles mentaux, psychiatriques ou neurologiques.
Musée de la folie
Le château se dresse juste au-dessus de la frontière avec l’Autriche. La rivière Mura qui sert de démarcation entre les deux pays depuis 100 ans, passe sous ses murs. Darja Farasin et Sonja Bezjak habitent Trate. Elles ont grandi à côté de l’institut où, à l’époque, environ 350 patient·e·s résidaient 24h/24. Alors que nous pénétrons dans l’enceinte du bâtiment, grand et froid, Sonja se souvient : « Les résidents et résidentes de l’institution marchaient parfois dans le village, mais il n’y avait pas de réel contact avec les habitants et les habitantes. » Lorsque la nouvelle de la fermeture est parvenue à leurs oreilles, certain·e·s ont eu peur de perdre leur travail à l’institut. Mais au final, le personnel a été muté dans les autres branches du Hrastovec Institute dans les autres villes alentour. Et 20 ans après la fermeture, Sonia se réjouit toujours de cette décision : « Je suis fière que la première ‘institution totale’ à être fermée en Slovénie, l’ait été ici, à Trate. »
Pour éviter que le château tombe en ruine et pour apprendre de l’histoire passée, les anciennes unités ont été transformées en musée de la folie. Sonja est la directrice. Une fonction que cette femme passionnée exerce de façon bénévole. « C’est notre héritage. Avec ce musée, nous voulons sensibiliser et faire avancer le respect des droits de l’homme des personnes qui vivent encore dans ces instituts aujourd’hui. Nous devons rejeter les institutions », argumente-t-elle.
La création d’instituts comme celui de Trate a débuté avec l’industrialisation, quand les Slovènes ont commencé à travailler en dehors de leur maison et n’étaient plus en capacité de s’occuper de leurs proches handicapé·e·s. Pendant l’occupation de la Styrie slovène par les nazis en 1941, beaucoup de déficient·e·s mentaux ont été exécuté·e·s. Dans la région, environ 600 personnes avec des handicaps ont été envoyées dans des camps de la mort en Autriche. Après la guerre, les châteaux et les manoirs ont été nationalisés et beaucoup ont été transformés en instituts de soin : orphelinats, hôpitaux, maison de retraite, centres pour personnes en situation de handicap, etc. Comme les résident·e·s étaient en grande partie inconnu·e·s, les documents retrouvés à Trate montrent qu’ils et elles étaient souvent affublé·e·s de surnoms comme « la Femme Mutante » ou « Julka la sourde et muette ».
Jusqu’aux années 1970, la vie au sein de l’institut de Trate était assez “traditionnelle”. Les résident·e·s alors appelé·e·s patient·e·s travaillaient dans les champs et les écuries. Les standards ont changé sous le socialisme, l’état décrétant que des personnes ne pouvaient pas vivre dans ces conditions. Le chauffage central et des toilettes furent installés et les premier·ères infirmier·ères embauché·e·s. « Les conditions sanitaires étaient désastreuses. Les infirmier·ère·s ont amené leur savoir dans l’institution. Et le travail des champs a également été aboli, car considéré comme de l’exploitation. Mais survivre sans travail était encore plus dur ‒ 350 personnes étaient désormais bloquées entre les murs », décrit sa collègue Darja. Deux décennies plus tard, les chambres portent encore les traces de ce passé. Les vitres des fenêtres étaient teintées pour que les patient·e·s ne puissent pas voir l’extérieur. À la cantine, pas de fourchette ou de couteau, la foule déshumanisée mangeait avec ses doigts et se jetait souvent de la nourriture.
Le manque de thérapie était compensé à coup de pilules, barrières, contention et camisoles de force.
Le personnel souffrait aussi de la situation. La nuit, un·e ou deux employé·e·s devaient veiller sur 80 à 120 personnes. Le manque de thérapie était compensé à coup de pilules, barrières, contention et camisoles de force. Les femmes étaient particulièrement vulnérables. Certaines d’entre elles ayant été abusées avant d’être prises en charge par l’institution, elles étaient soumises à la stérilisation ou la contraception de force, aux avortements et à la perte de la garde de leurs enfants. Les valises et autres biens qui avaient été pris aux occupant·e·s à leur arrivée restaient dans le château. Sonja se souvient de l’histoire d’une femme qui adorait aider dans les champs et n’enlevait jamais ses bottes en caoutchouc, même pour dormir. Le personnel avait fini par accepter ce comportement puisqu’il tenait cette femme pour “folle”. « Lorsqu’elle est morte, on a découvert qu’elle y avait caché de l’argent ! » raconte la directrice. La patiente était prête à tout pour conserver quelque chose “rien qu’à elle”.
L’équipe de l’époque ne cautionnaient pas la façon dont les patient·e·s étaient traité·e·s, précise Sonja qui avec ses collègues a recueilli les témoignages d’ancien·ne·s employé·e·s. Le manque d’hygiène et la surcharge de travail les inquiétaient particulièrement. Cependant, tous et toutes travaillaient dur et faisaient de leur mieux et les critiques actuelles à l’encontre de l’institution les heurtent aussi. Iels ont internalisé l’idée que ce qu’il faisait était le maximum qui pouvait être fait, et en ce sens la meilleure chose à faire.
Alors que dans d’autres pays le processus de désinstitutionnalisation suit son cours depuis un long moment, en Slovénie, les vieilles institutions sont robustes. Aujourd’hui, parmi les deux millions de personnes qui habitent le pays, près de 2 700 vivent dans des instituts spécialisés et environ 700 dans des unités fermées, d’après un document interne au ministère des Affaires sociales. La législation slovène autorise une augmentation du nombre de lits, en contradiction avec les préconisations de l’Union européenne et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
Retour en communauté
Via deux projets financés par l’Europe, les choses ont commencé à changer de façon plus positive. L’un d’entre eux consiste à reloger les résident·e·s de l’institut de Dom na Krasu à Dutovlje, dans la région de Primorska ‒ à la frontière avec l’Italie ‒ dans des résidences communautaires. Ce projet marque les débuts de la fin des “institutions totales” dans cette partie du pays. Le respect et la promotion de la dignité des bénéficiaires de ces services (des adultes souffrant depuis longtemps de problèmes de santé mentale et des adultes avec des déficiences du développement et des troubles mentaux) sont au cœur du programme. Là, ces personnes bénéficieront de compétences et d’un soutien adaptés pour les aider à réintégrer la société et à vivre le plus indépendamment possible, malgré les problématiques et défis qui se posent à eux. Le projet à 2,2↓millions d’euros est co-financé par le fonds social européen à hauteur de 1,8 million d’euros.
À Dutovle, cette volonté de reloger les patient·e·s remonte à 2003 quand la première résidence communautaire a ouvert. Depuis, 171 personnes ont été retirées des institutions et placées dans des foyers et sont mieux intégrées à la communauté locale. Plutôt que d’être mis·e·s à l’écart, enfermé·e·s, les resident·e·s vivent en très petits groupes ou seuls, font leur propre emploi du temps, retournent au travail, s’adonnent à leurs passions et surtout profitent de la vie de famille et intime dont ils et elles étaient privé·e·s au sein des autres établissements. Le personnel des instituts (en voie de disparition) continue de les assister dans les tâches du quotidien sur lesquelles ils ou elles butent.
« Il ne devrait pas y avoir de punition sans crime, mais nous criminalisons la détresse mentale, nous retirons les improductif·ve·s des rues pour les garder propres »
Urška Sorta Kovač est assise sous le tilleul du jardin face à l’institut Dom na Krasu, qui se vide chaque jour un peu plus. Elle travaille ici depuis 1996 et est l’une des professionnel·le·s les plus compétent·e·s de son secteur. Malgré les récentes améliorations, elle remarque que « la Slovénie est encore une société très institutionnalisée. Il ne devrait pas y avoir de punition sans crime, mais nous criminalisons la détresse mentale, nous retirons les improductif·ve·s des rues pour les garder propres ». Ce lent chemin vers la désinstitutionnalisation est à l’image des choix passés de la société slovène. Et pourtant, Urška l’assure, quand les résident·e·s sont intégré·e·s à la communauté, les choses changent à bien des niveaux.
Les vies des résident·e·s des foyers et du staff ne sont plus les mêmes désormais, assure Urška. Les résident·e·s oublient beaucoup de choses après un passage en institution ‒ chacun·e a besoin de temps pour s’acclimater à son nouvel environnement. Il y a d’abord une période de guérison, car un déménagement est une expérience stressante pour tout le monde. L’équipe de professionnel·le·s, de son côté, doit complètement modifier sa façon de penser. « Il n’y a pas que les résident·e·s qui sont ‘institutionnalisé·e·s’, le staff aussi. Les professionnel·le·s doivent s’occuper de chaque individu de façon beaucoup plus personnelle, en fonction de leurs besoins. Ça casse la routine. Les véritables attentes et demandes des personnes qui ont été niées pendant des années peuvent enfin émerger », explique-t-elle. C’est d’ailleurs ce qu’Urška Sorta Kovač fait tous les jours : elle aide les gens à formuler et atteindre leurs buts. Même s’il s’agit simplement d’aller au cinéma, elle leur apporte du soutien à chaque étape.
Les résident·e·s peuvent à présent façonner leur vie quotidienne comme bon leur semble ‒ et ce quotidien ressemble comme deux gouttes d’eau à celui d’une personne saine d’esprit. Joc n’a pas eu la possibilité de vivre dans une résidence communautaire non institutionnalisée. Si tel avait été le cas, il aurait sûrement trouver un emploi à la quarantaine et ainsi gagné un revenu stable, ce qu’il n’a jamais eu. Et aujourd’hui, il ne se demanderait peut-être pas où il dormira ce soir. « Il ne s’agit pas seulement de vivre seul ou en petit groupe, il s’agit de ne pas être passif, de prendre activement part à sa vie, d’avoir son mot à dire », poursuit Urška. L’une des plus importantes nouveautés introduites dans cette prise en charge est l’implication des usager·ère·s, y compris dans des groupes de travail et ce jusqu’au management de la structure.
Désinstitutionnalisation et réintégration
Le dialogue avec la communauté est la clef pour une intégration réussie, mais le chemin n’est pas toujours aisé. « Bien sûr, il y a de la peur, mais la question est de savoir comme comment cette peur s’intensifie et pourquoi. L’idée de ce projet est de travailler à tous les niveaux ‒ usager·ère·s, proches, personnels, communauté », explique le directeur, Goran Blaško, qui travaille ici depuis cinq ans et est entré en fonction à un moment un peu complexe. Le travail a été particulièrement éprouvant pendant la pandémie, lorsqu’il était difficile de trouver des logements pour les gens, explique-t-il.
Le projet ‒ avec ses deadlines et prérequis ‒ est aussi très limité. Il a une durée de trois ans et est confronté à la surpopulation et au manque de place, surtout pour les personnes sous main de justice. Il y a eu des cas où les gens ont dû dormir dans le couloir. « Mais la solution n’est pas d’augmenter les capacités ! C’est de travail communautaire dont nous avons besoin », met en garde Urška. En clair, la désinstitutionnalisation ne sera pas complète quand le dernier résident ou la dernière résidente sortira d’un institut fermé, mais quand la société regardera d’un autre œil et acceptera cette importante part d’elle-même.
La réussite et le rythme auquel avance un processus de réintégration dépendent du temps que la personne a passé en dehors de la communauté (la moyenne en institut spécialisé est de 12,5 ans d’après un document ministériel sur la “Stratégie de désinstitutionnalisation”) et du soutien dont elle bénéficie. Sur ce plan, même si son compteur affiche 15 ans en institut et hors de la société, Joc est chanceux. Andraž a écrit un livre sur sa vie ‒ intitulé Titov sin, car Joc imagine souvent qu’il est le fils du leader yougoslave ‒, ce qui lui a attiré de la sympathie et un réseau social.
Pancakes et basket
En sortant de l’appartement de Joc, Andraž se remémore brièvement une fois où il faisait des pancakes à l’institut de Dutovjle ‒ désormais en transition. L’un des patients n’avait pas de dents, alors pour ne pas qu’il s’étouffe, il lui avait été interdit d’en manger. « Il aurait donné n’importe quoi pour un pancake. Il devenait agressif, car il était le seul à ne pas pouvoir en manger. Je me suis demandé ce que je pouvais faire et j’ai coupé le pancake en très petits morceaux. » L’attitude de l’homme a changé immédiatement. « Je lui ai demandé s’il voulait que je lui en refasse un. Il a répondu non et qu’il fallait qu’il en reste pour les autres. » Qu’est-ce qu’Andraž essaie de dire ici ? « Que comme on dit à Trieste: la liberté est thérapeutique. Nous devons ouvrir les portes des institutions et laisser les âmes indépendantes s’épanouir », décode-t-il.
Après m’avoir saluée, Andraž et Joc vont prendre un énième café. Joc prépare encore une campagne sur l’importance de la désinstitutionnalisation en Slovénie. Il se bat tous les jours et Andraž l’aide autant que possible. Mais malgré les grandes ambitions de Joc, la vie se rappelle constamment à lui, et à la fin de la journée, il se demande où il dormira, ce qu’il mangera et qui gagnera ce match de basket tant attendu.
This story is part of the YOUTHopia campaign, a journalistic project shedding new lights on the EU Cohesion Policy.
Désinstutionnalisation à l'arrêt, le cas de la Slovaquie
Depuis une dizaine d’années, une grande partie des pays d’Europe centrale et de l’Est se sont engagés dans un processus de désinstitutionnalisation de la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Cependant, tous les pays n’avancent pas à la même vitesse. En Slovaquie, le processus semble même être au point mort, analyse la psychiatre et professeure, Vesna Švab.
Comme l’illustre cet article, la Slovénie peine à réellement désinstitutionnaliser la prise en charge de la santé mentale. Mais ce n’est pas le seul pays d’Europe centrale à être dans ce cas. En Slovaquie, par exemple, la situation est assez similaire. Le pays est officiellement engagé dans le processus de désinstitutionnalisation depuis une dizaine d’années. La Slovénie fait également partie des pays qui ont reçu des fonds européens pour aider cette transition. Avec peu de résultats jusqu’à présent. La somme a été utilisée pour maintenir aux normes ou rénover des structures existantes – il n’est donc pas question de désinstitutionnalisation – ou pour construire d’autres structures plus petites – dans ce cas, il n’est toujours pas question de désinstitutionnalisation, mais de “transinstitutionalisation”. Ce terme désigne le processus par lequel des groupes d’individus dont la prise en charge est supposément désinstitutionnalisée grâce aux politiques de soin en milieu communautaire se retrouvent finalement dans d’autres institutions. Elles peuvent être plus petites, ou différentes, mais elles restent des institutions. Il ne les sort pas de l’institution pour les réintégrer dans la société.
Une situation qui en Slovaquie, comme en Slovénie, est critiquée par l’UE, les usager·ère·s et les associations. Ce que nous – ONG – préconisons, c’est le développement et l’amélioration des services et programmes de réinsertion sociale reposant par exemple sur la réadaptation professionnelle, les emplois aidés, le logement, les centres de santé mentale communautaires… Nous plaidons également pour que les personnes souffrant de troubles psychiques puissent rester au maximum chez elles et recevoir le soutien ou les soins nécessaires depuis leur maison.
En Slovaquie, les structures de soin dépendent des autorités locales et donc de leurs décisions. Une particularité qui ralentit la désinstitutionnalisation du système de santé, toutes les municipalités n’étant pas favorables à cette évolution. De plus, les ONG qui plaident en sa faveur sont rarement impliquées dans le processus. Pourtant ce sont précisément ces ONG qui ont l’expertise la plus poussée quand il s’agit de faire valoir et respecter les droits humains des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et aujourd’hui, dans toute la Slovaquie, ces petites organisations sont les seules à offrir des services de réadaptation et réinsertion. En d’autres mots à désinstitutionnaliser.